N’oublions pas la géométrie
Dans cet article déjà paru dans le n° 573 de décembre 2021 des Cahiers pédagogiques  , Valentina Celi questionne l’enseignement de la géométrie en cycle 1 … Par la manipulation, les diverses formes de perception et la verbalisation, voici comment l’enseignant peut amener les élèves à construire leurs premières connaissances géométriques dès la maternelle.
, Valentina Celi questionne l’enseignement de la géométrie en cycle 1 … Par la manipulation, les diverses formes de perception et la verbalisation, voici comment l’enseignant peut amener les élèves à construire leurs premières connaissances géométriques dès la maternelle.
Valentina Celi
© APMEP Juin 2023
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅♦⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
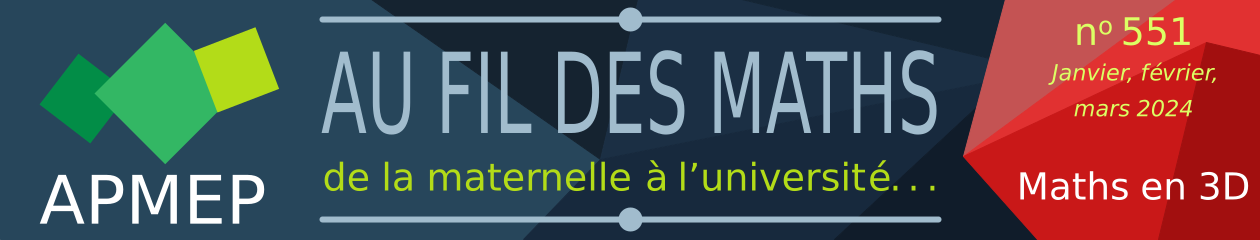
Une réflexion sur « N’oublions pas la géométrie »
Les commentaires sont fermés.